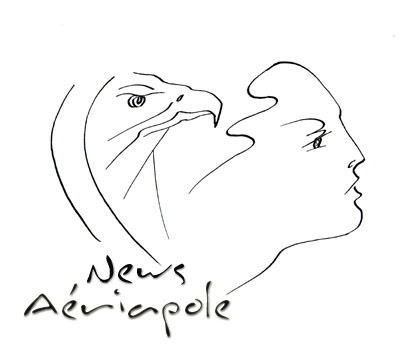|
| Licence Google - Energies propres |
En comparant les deux énergies, nous avons appris qu'un kWh de gaz est
moins efficace, ne convertissant qu'environ 90 à 80 % de son énergie en
chaleur (sauf pour les chaudières à condensation, plus économes), contre près de 90 à 100 % pour un kWh d'électricité. Cependant,
l'écart de prix est flagrant : le kWh de gaz coûte 0,079 €, tandis que le kWh
d'électricité s'élève à 1,97 €. Sont omis les frais d'abonnement et la TVA.
Les sites des fournisseurs d'énergie, remplis de cookies, de souhaits de prise de RV et de jargon
technique, n'ont fait qu'augmenter notre confusion.
Pour obtenir une
explication claire, nous nous sommes tournés vers l'intelligence
artificielle. En quelques secondes, elle a fourni ci-dessous, une analyse qui nous permet de
mieux comprendre la situation.
Le grand
paradoxe énergétique : pourquoi nous pousse-t-on vers l'électricité ?
Alors que
l'État nous encourage activement à abandonner le gaz au profit de l'électricité
pour nos logements, un regard critique sur la situation soulève des questions.
À l'heure où le prix du gaz est manifestement plus avantageux au kWh
que celui de l'électricité, pourquoi cette politique est-elle si fermement
défendue ? Le raisonnement officiel met en avant des objectifs de décarbonation
et d'indépendance énergétique, mais ces arguments tiennent ils la route face
aux réalités économiques et industrielles ?
Une
transition "verte" à quel prix ?
On nous explique
que la transition vers l'électricité est un pas essentiel vers la neutralité
carbone.
Mais qui peut ignorer le fait que le gaz est une énergie fossile moins polluante que le charbon, et que l'électricité française, bien que décarbonée par le nucléaire, reste soumise à un marché européen qui l'indexe sur le coût des centrales à gaz ? Le discours sur l'indépendance énergétique est-il crédible quand nous dépendons de ces mêmes mécanismes de marché qui font flamber nos factures ?
La promotion
des pompes à chaleur (PAC) est présentée comme la solution miracle,
grâce à leur excellent rendement. Mais ces systèmes, malgré les aides,
représentent un investissement initial lourd. Faut-il donc s'endetter pour une
transition qui, dans les faits, ne nous met pas à l'abri de l'instabilité des
prix ?
Qui tire les
ficelles de ce marché ?
Le nœud du problème semble résider dans un système de tarification opaque. Si la France dispose d'une électricité moins chère à produire que la plupart de ses voisins grâce au nucléaire, comment expliquer que les fournisseurs, même les concurrents d'EDF, nous la revendent à des prix aussi élevés ? Où se situe la logique économique derrière la vente à bas coût de notre électricité à d'autres pays, pour ensuite la racheter à un prix exorbitant ?
Cette
situation soulève une question fondamentale : à qui profite réellement cette
politique de transition énergétique ? Est-ce une stratégie bienveillante pour
l'environnement et le consommateur, ou une manœuvre pour favoriser certains
acteurs du marché au détriment du pouvoir d'achat des Français ? Où se trouve le
bien-fondé de ces choix politiques, qui nous mènent vers un avenir où nous payons
plus cher pour une énergie que nous produisons nous-mêmes.
Vrai ou faux ? le mois d'août et le repos estival nous permettront la réflexion.